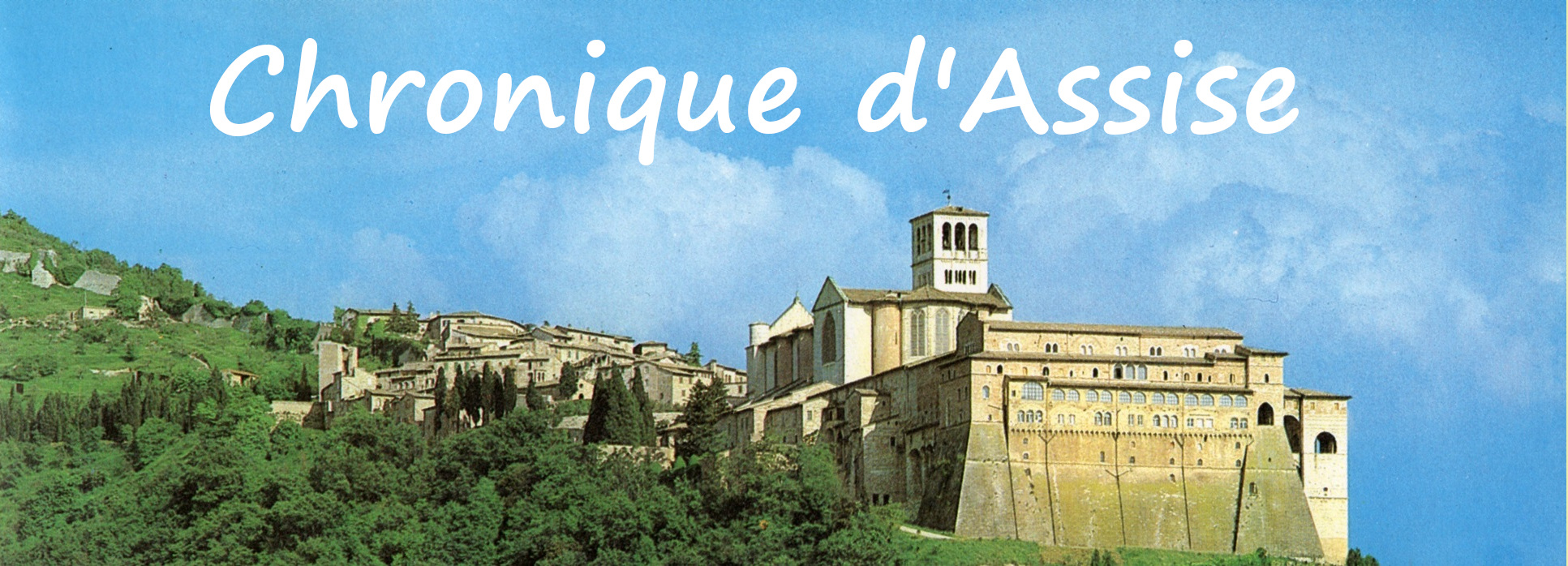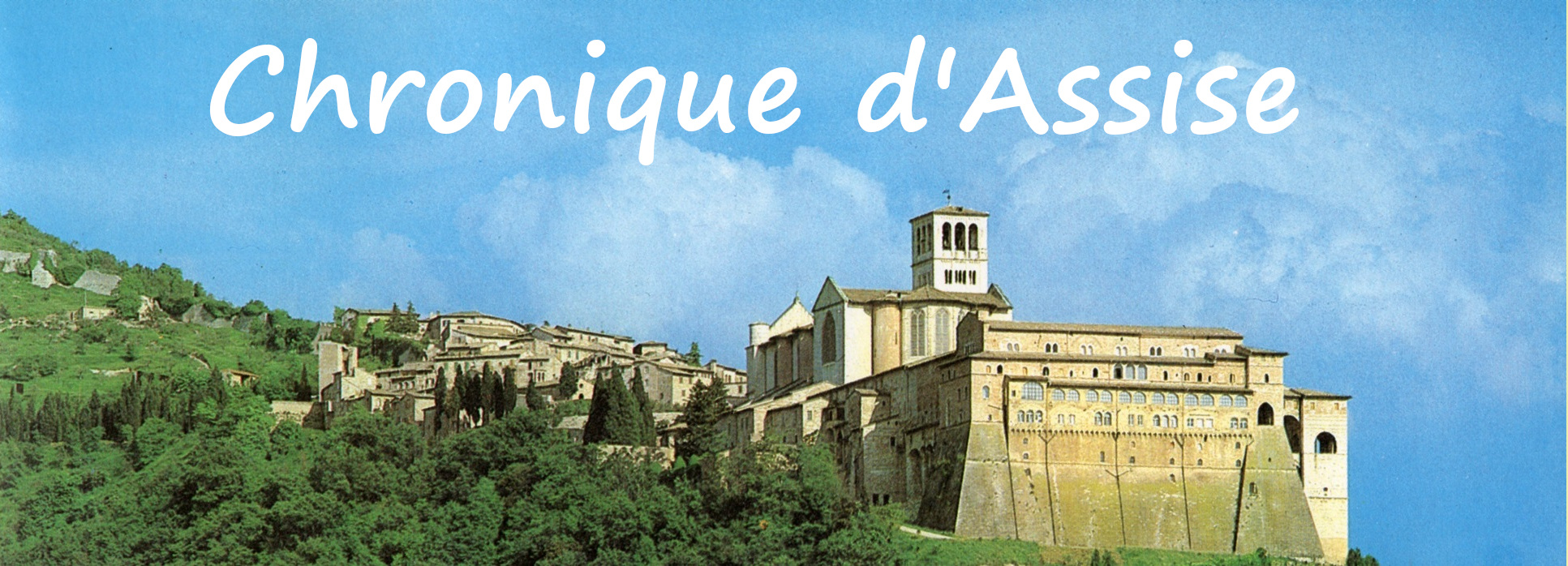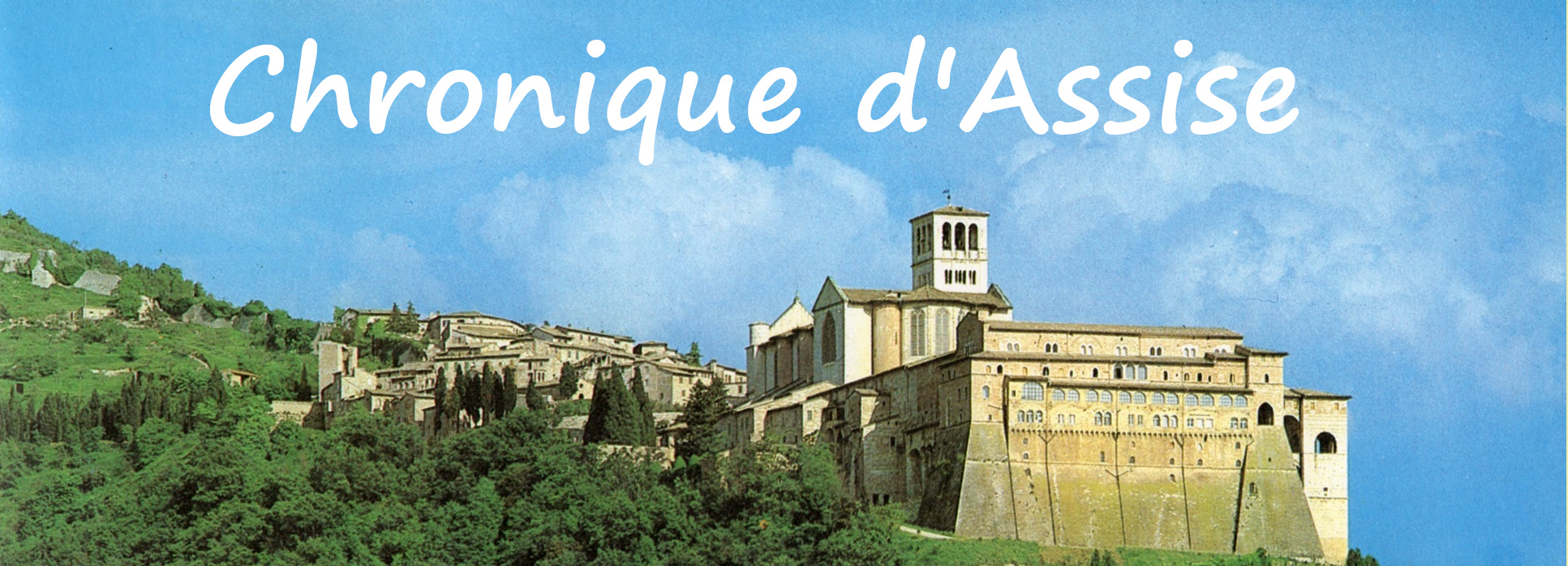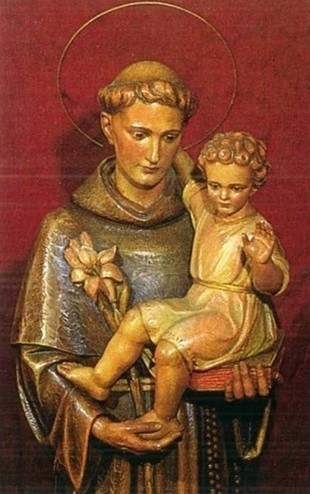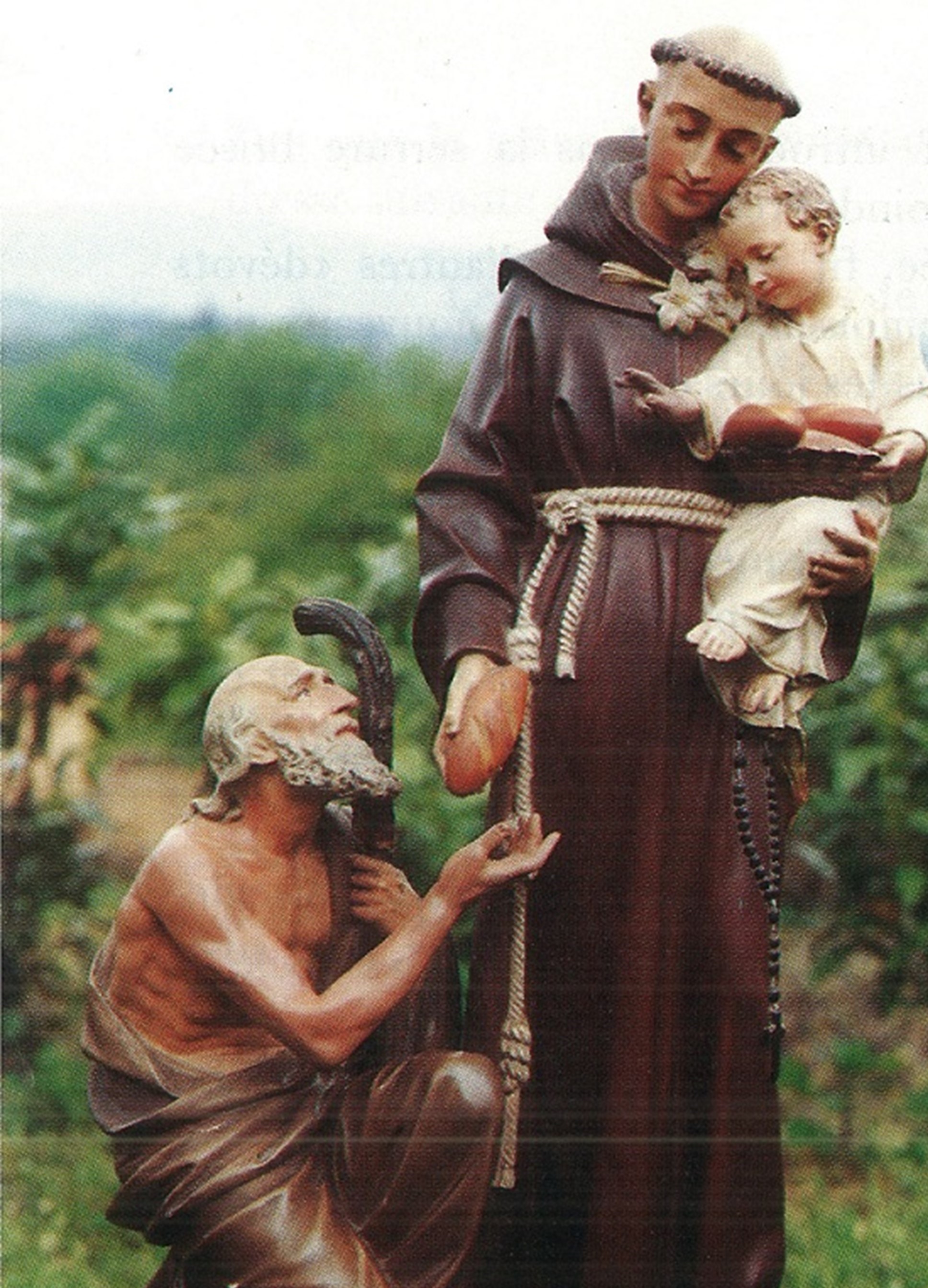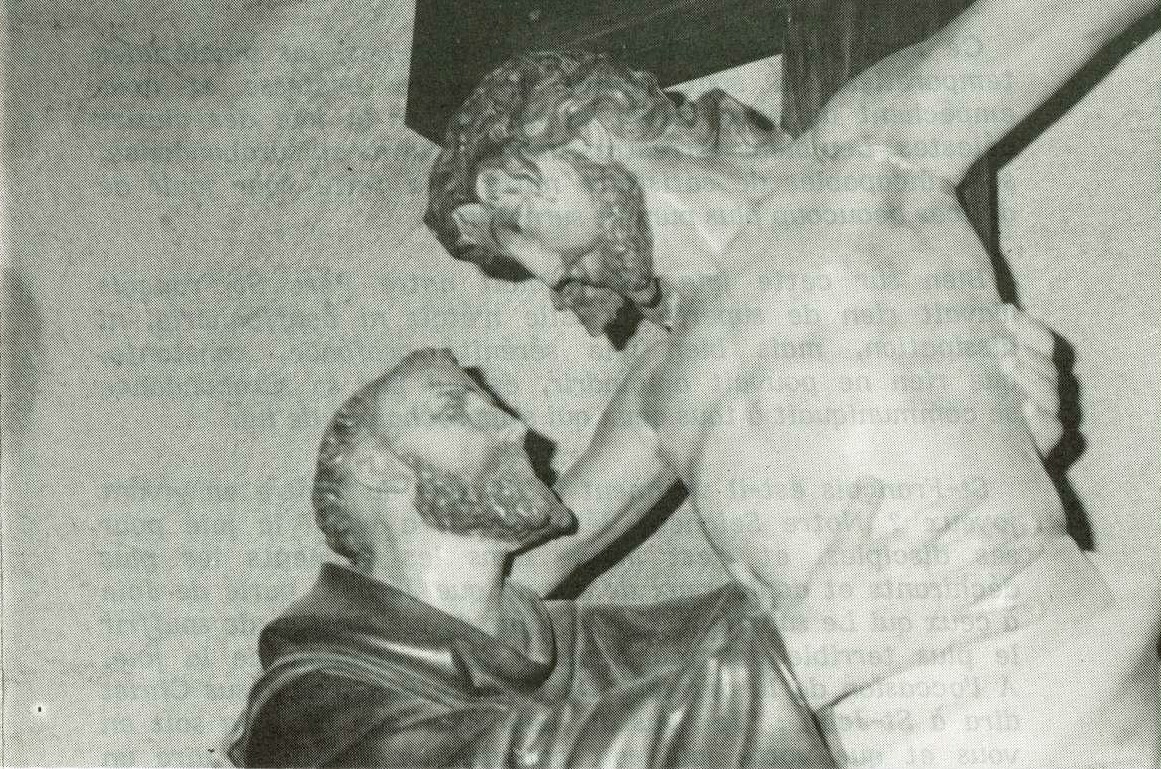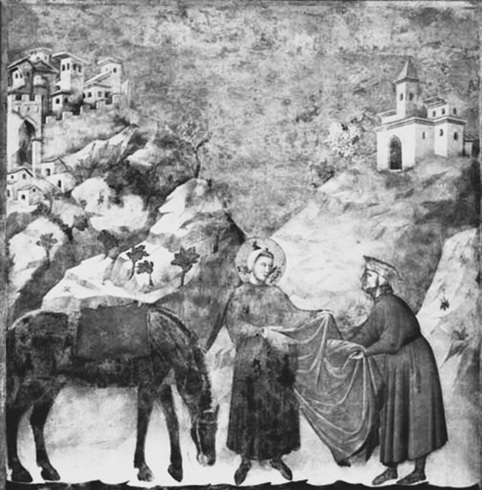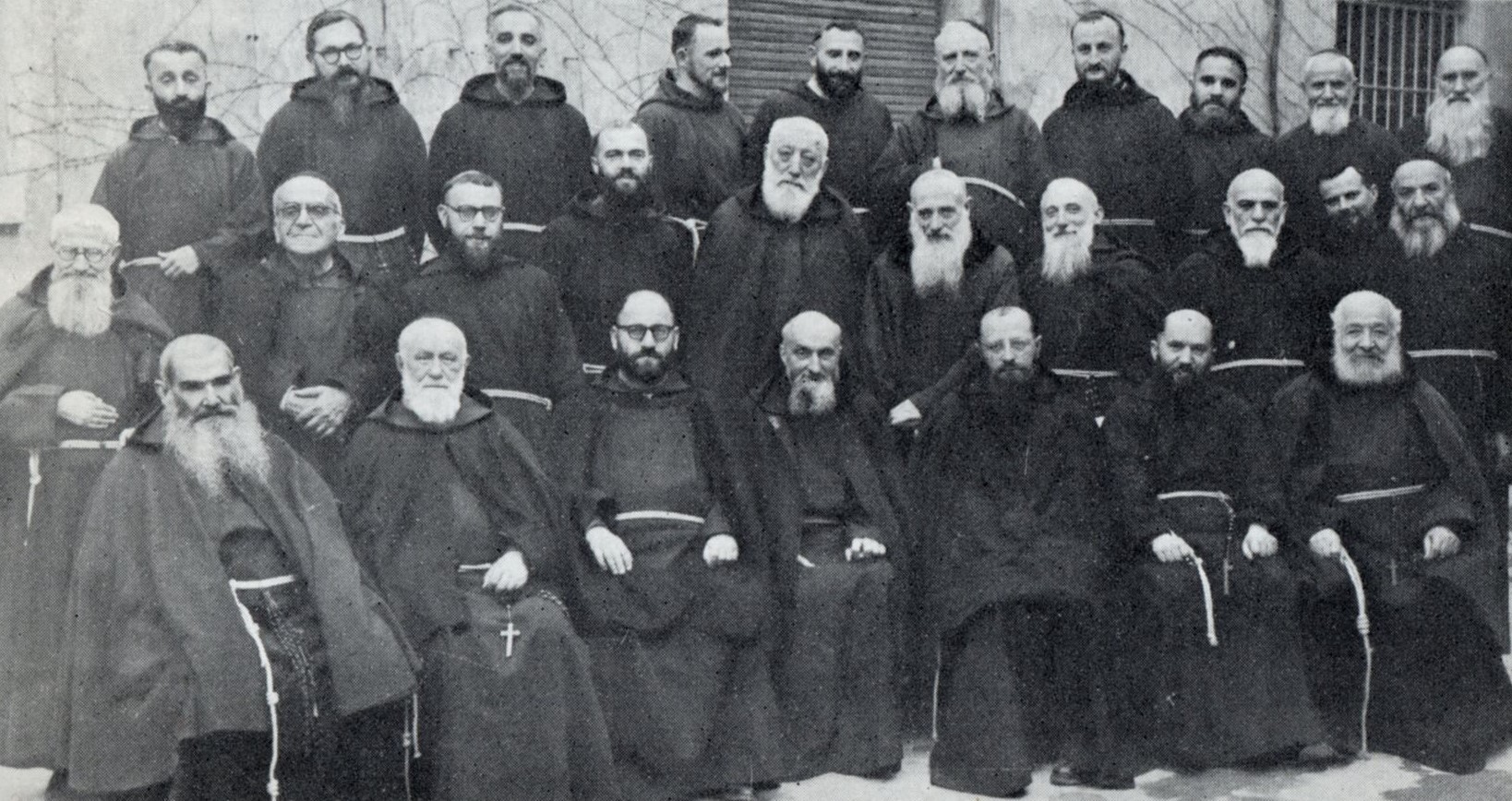Nos activités > Nos articles
Actualités
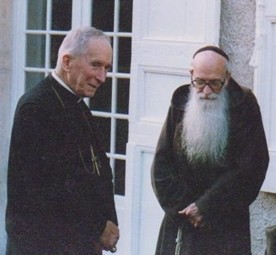
La déclaration du 21 novembre 1974
1974 - 2024 : 50 ans
Publié
le 20/11/2024
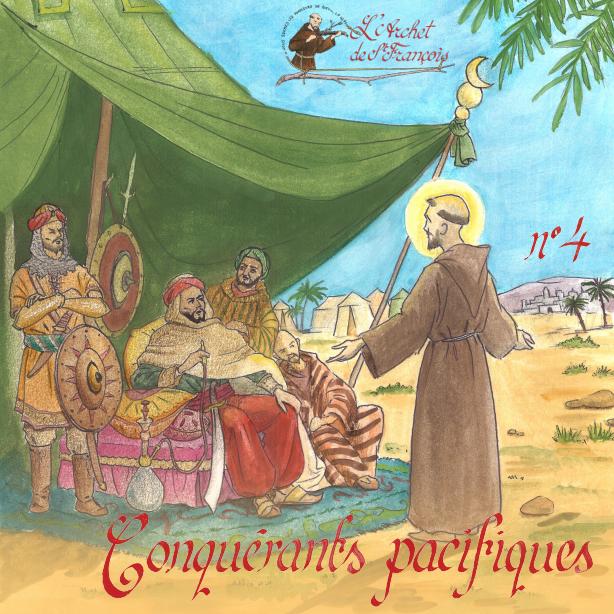
Conquérants pacifiques
L'Archet de Saint François n°4
Publié
le 05/11/2024

"Malheur à l'homme par qui le scandale arrive" (Mt. 18,7)
A propos de l'image blasphématoire publiée par Charlie-Hebdo le 15 août 2024
Publié
le 12/09/2024
Lettre aux amis

Lettre aux amis de Saint François n°3 - 1986
Le Saint Nom de Jésus
Publié
le 26/09/2024

Lettre aux amis de Saint François n° 2 - 1985
Fête de St Fidèle de Sigmaringen
Publié
le 28/08/2024

Lettre aux amis de Saint François n°1 - 1984
Première lettre aux bienfaiteurs après l'installation à Morgon
Publié
le 15/06/2024